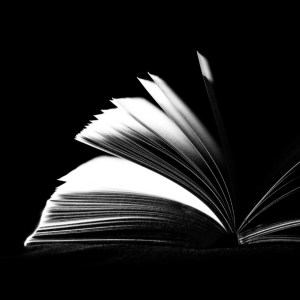Il y a quelques jours, je m’agaçais sur les réseaux sociaux. J’y poussais un coup de gueule (ce qui est plutôt rare de ma part) et pensais qu’il serait assez succinct si bien que je le posais là et non ici où, généralement, je prends le temps de développer un peu plus ce qui me fait ratiociner.
Pour autant, m’apercevant à la fois que, décidément je ne saurai jamais me contenter de faire court quand je suis emportée et que ce texte a eu une sacrée portée, je le remets ici parce que, comme tu le sais, je ne suis pas une Face-Fille-facile et que, conséquemment, il n’est accessible que dans l’entre-soi de mon cercle de contacts (même si, pour une fois, j’ai quelque peu élargi la confidentialité de la publication sus-citée).
Je le remets donc ici puisque je l’avais omis, en le développant un peu plus avant (tout petit peu plus) parce que je ne suis pas loin d’être persuadée que c’est une problématique sur laquelle il est nécessaire de se pencher (sans chuter) :
On peine sérieusement à vivre de sa plume, on fait de l’alimentaire à côté parce que ça ne paie pas les croquettes d’Huxley (d’autant que le lapin les lui descend aussi sûrement que l’on descend aux enfers), on se fait une raison parce que l’on sait que très rares sont ceux qui parviennent à en vivre et on s’acquitte du reste avec entrain et coeur parce que, quand on met du coeur, ça rend les choses plus légères.
Parallèlement, on trouve des idées pour tout de même allier passion et remplissage du frigo (et du bol du lapin-chat), on se torture le ciboulot, on devient créateur au lieu de râler. Et, du coin de l’oeil, on guette les opportunités, les demandes de rédaction, les appels à textes, on garde la plume en l’air, prête à être dégainée.
Or, de plus en plus de webzines et autres éditions en ligne (et même certaines faites de ce bon vieux et odorant papier) proposent des appels à textes en mode concours avec pour seule récompense à la clé la « gloire » de voir son petit texte publié, champagne les gars. Du contenu gratuit, des textes à moindre frais.
Hier soir, encore mieux, je tombe sur cet appel à « poèmes » où il est demandé des textes courts qui seront apposés sur des montres commercialisées avec, pour tout salaire du travail que la marque estime mériter, une invitation à l’événement de lancement de ladite collection de montres (j’ai posé des questions pour bien m’en assurer).
Malin, non ? Pas besoin de payer du droit d’auteur, pas de cession des droits de propriété intellectuelle, rien, du gratis, de l’économie de créativité, bien joué ! Je présume que celui qui a dessiné le modèle, lui, ne sera pas juste invité à boire une coupette (je suppute également qu’ils n’ont pas fait d’appel à champagne en promettant au vigneron qu’il aurait la chance d’être de la fête s’il fournissait des bulles à toute l’assistance)…
Les auteurs sont pour la plupart en précarité et notamment parce que l’on estime que le travail d’écriture ne mérite pas de rémunération autre que celle de cette petite gloire éphémère, cette substantielle nourriture égotique et ça fonctionne très bien parce qu’il y a mille personnes en mal de reconnaissance pour accepter ces conditions qui plombent encore plus un métier déjà affreusement et de plus en plus mal rémunéré. Même les poètes maudits parvenaient à assurer un minimum leur pitance en vendant quelques textes, de ci de là, à des journaux, aujourd’hui ce n’est plus le cas, ça n’existe même pas.
De même, alors que je monte des ateliers littéraires et peine à trouver un lieu, les seuls ayant jusqu’alors répondu positivement l’ont fait sous la condition impérieuse que j’offre mes services à titre gracieux, de l’animation bénévole pour des communes en mal de culture et d’idées.
En acceptant ce type de conditions, en répondant à ces appels, on fait partie du problème, on l’entretient et on dit haut et fort que oui, le travail d’écriture c’est juste un putain de hobby.
Je ne blâme pas la marque et c’est pourquoi je ne la citerai pas. Je ne la blâme pas car, au fond, elle n’est pas à blâmer. Pourquoi aligneraient-ils une part de leur budget pour des poèmes quand il leur suffit de lancer un tel appel pour en avoir à profusion, gratis ? Franchement, si on propose du pain gratuitement, peut-on en vouloir à celui qui en veut de ne pas se rendre chez celui qui en vend contre un vrai paiement, fut-il mérité ? Non, le noeud gordien vient de celui à qui suffit quelques flagorneries.
Voilà, je suis juste en colère.
Ce problème, je le sais, existe pour d’autres métiers artistiques (photo, musique), et nombreux sont ceux qui, en commentaires, ont fait écho à ma colère. Alors réfléchissez bien à chaque fois que vous participez à ces appels… les lancez ou les relayez…
Il ne faudra pas s’étonner le jour où le métier d’auteur/écrivain/romancier aura cessé d’exister.

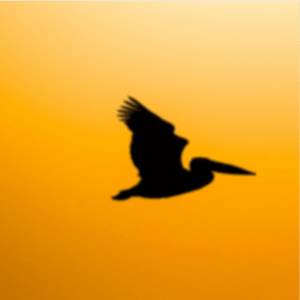 Lorsque mon fils me demande la définition d’un mot, j’ai pour habitude de l’envoyer voir La Rousse…
Lorsque mon fils me demande la définition d’un mot, j’ai pour habitude de l’envoyer voir La Rousse… Ils nous ont dit que l’on pouvait fanfaronner, que l’on pouvait courir à poil en hurlant que l’on était sélectionné, que l’on pouvait danser comme un poulet pour célébrer dès que l’on aurait vu le titre de notre nouvelle dans la liste de celles retenues.
Ils nous ont dit que l’on pouvait fanfaronner, que l’on pouvait courir à poil en hurlant que l’on était sélectionné, que l’on pouvait danser comme un poulet pour célébrer dès que l’on aurait vu le titre de notre nouvelle dans la liste de celles retenues.