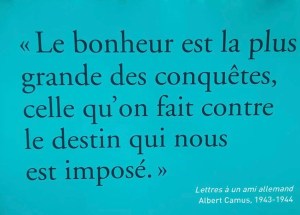sur mes pas
Je suis revenue sur mes pas.
J’avais fait une promesse, celle de revenir voir les élèves qui m’avaient accueillie pour étudier « Les fleurs roses du papier peint » par effraction, pour recueillir leurs impressions une fois la lecture terminée.
Cette fois, je suis venue sans nervosité, je les connaissais (un peu) et j’étais heureuse de les retrouver.
Leur institutrice avait fait en sorte que tout le livre soit lu, à l’exception du dernier chapitre, le chapitre vingt-trois, les quelques dernières pages, les quelques derniers mots. Le dénouement, avait-elle estimé, me revenait de droit, à moi de leur livrer, à moi de leur dire, à moi de leur lire, à moi de lire leur visage, leurs yeux embués, leur bouche entrouverte.
Alors on a commencé par ça. Par la lecture du chapitre vingt-trois : « Et voir enfin les fleurs roses du papier peint ».
J’ai lu, aussi lentement que possible, j’ai scruté chacune de leurs réactions tout en lisant (relisant pour moi, redécouvrant, il y avait longtemps que je n’étais pas allée à cet endroit-là de mon roman, on évite généralement dans les lectures publiques d’évoquer la fin), ma gorge s’est serrée, parce que j’étais revenue sur mes pas, mais j’ai continué sans rien en montrer.
J’ai lu la dernière phrase et, parce que j’étais revenue sur mes pas, j’ai pris un temps pour refermer le livre, un temps court, un temps respirant.
Une fraction de seconde, j’étais revenue sur mes pas. Un an en arrière, au moment précis où j’écrivais ce chapitre vingt-trois, ces quatre derniers mots-là.
Revenue sur mes pas pendant une fraction de seconde je n’étais pas là, pas avec eux, pas dans cette salle, dans cette école en leur présence.
Une longue, une puissante fraction de seconde en absence.
Une ombre furtive posée sur le coeur, une presque transe, une fraction de seconde en absence.
Un instant furtif tête tournée, chemin examiné, vertige éprouvé, une fraction de seconde en apesanteur, des fleurs sur la peau, les yeux dans l’eau.
Et puis je suis revenue à moi, à eux et à leurs yeux à eux, pleins d’attente et de questions.
J’ai accueilli leurs mots, leurs inquiétudes face à la dystopie décrite dans mon roman et, en les écoutant, j’ai su qu’ils avaient compris que tout est entre leurs jeunes mains. Que ce sont eux qui feront que cela arrivera ou non demain.
Je suis revenue sur mes pas, une fraction de seconde en absence, et en reprenant conscience je les ai vus eux, avancer tout droit, décidés et concernés par le monde de demain, prêts à se battre comme Gilda, prêts à lutter comme Mildred, et je les ai aimés tout mon coeur, de toute mon âme pour ce combat.