
Après presqu’une année, les résultats tant attendus du Prix de la Nouvelle Érotique sont enfin tombés en cette fin de journée, par surprise, comme de bien entendu.
Ne crois pas, Ô lecteur impatient, que je vais te livrer tout ça dès le préambule de l’article, des mois que l’on patiente à se demander s’ils finiront par arriver, à ton tour de ronger un peu ton frein.
Depuis mars, d’attentes en rebondissements, quelques messages lénifiants nous arrivent pour nous enjoindre à patienter. D’abord le confinement qui se prêtait mal à la proclamation d’un résultat couronnant un érotisme ardent (avouons que ça se discute, qu’avions-nous de mieux à faire en cette période, enfermés et avec tout plein de temps à revendre, que de nous livrer à nos envies à l’envi, ad libitum en somme ? Mais soit, ça se comprend).
Puis, post confinement, toute la difficulté de réunir un jury aussi talentueux qu’éclectique et d’âge varié, d’aucuns préférant du présentiel (pour de l’érotisme, c’est peut-être en effet mieux), d’autres de la Visio (on sait aussi combien la vidéo peut avoir son charme en bagatelle), les deux points de vue s’entendant.
Et puis, lecteur qui, je le sens bien, prend la diagonale-lecture-rapide pour en venir au coeur du sujet (enfin, du résultat), un petit changement de présidence du bureau associatif avec tout ce que cela peut comporter de complexité, et nous voilà passant de report en report, avec du « bientôt » dedans digne d’une composition de bac philo : « qu’est-ce que « bientôt » au regard de la relativité temporelle ? Vous avez quatre heures ».
Le problème avec l’attente, c’est que ça finit par créer des attentes. Et, entre la nuit de ma participation et les résultats, j’ai fini par concevoir des espoirs que je n’avais pas au départ. Si ma sélection parmi les trente finalistes m’a surprise (rappel des faits : j’avais failli jeter l’éponge suite à une grippe carabinée et une fièvre aussi inhabituelle que violente, j’étais déjà juste ravie d’être parmi les 233 sur 300 à être allés au bout et d’avoir renvoyé quelque chose dont je n’avais pas honte), tout ce temps a créé comme une possibilité, une ouverture, un possible.
Alors, quand après des mois d’attente, un petit message annonçant que les résultats étaient dans nos boîtes mails, mon coeur s’est emballé (le coeur a ses raisons. et elles sont parfois très cons…) et j’en ai oublié le rêve que j’avais fait. Pour être totalement honnête et ouverte, j’ai même un peu (carrément) fait l’enfant autruchier en traînant des pieds (enfin des doigts) pour lire ladite missive électronique, cherchant soutien ici et là pour ne pas l’ouvrir seule, à un cheveu de supplier quelqu’un de le faire pour moi.
Toute à mes battements tachycardiques, j’ai donc oublié le rêve d’il y a peu, et ceux qui me connaissent savent combien mes rêves ne se trompent (presque) jamais, combien ils m’annoncent bien des vérités (parfois fort inconfortables pour moi, parfois plutôt pour les autres qui, de ce fait, ne peuvent pas tellement me rouler dans la farine de la duplicité), j’ai rêvé donc, des résultats.
Dans mon rêve, comme le Jury n’avait guère trouvé le moyen de se réunir et débattre, les Avocats du Diable avaient proclamé le lauréat et ceux qui auraient la joie de faire partie du recueil, un peu à la va-vite face à la pression des participants aux abois, limite tirage au sort : « faut leur donner un truc, les gars, un résultat, là, on ne les tient plus on ne les tient pas, on y va, quoi ».
En revanche, une secrétaire sans doute zélée et Microsoft-addicted avait pris soin de faire un magnifique (!!) powerpoint envoyé à chacun des écrivains nocturnes lesquels, d’un doigt impatient, devaient glisser d’une vignette à l’autre pour découvrir de tout aussi magnifiques (réexclamons-nous) illustrations avec titre de la nouvelle et nom de l’auteur pour découvrir si oui ou non ils étaient dedans. Et j’avais beau glisser et glisser encore mon doigt tremblant, point de « Sas d’entrée » (titre, lecteur au sens déductif aiguisé, de ma nouvelle encore en lice). Je me suis réveillée triste et désolée, espoirs piétinés.
Si mon songe s’est avéré délirant concernant la présentation sus-citée (et c’est mieux, hein, soyons francs), point de power point (à dire sans l’accent, je sais c’est navrant), il n’a pas été détrompé quant aux résultats. Je n’en suis pas (tu vois ? Tu l’as ta réponse, lecteur agacé par mes circonvolutions et autres explications empesées).
La bonne nouvelle, c’est que je vais pouvoir prendre le temps de décider de comment je vais utiliser ces deux nouvelles (la mienne, le sas d’entrée ; et le résultat qui a sans aucun doute quelque chose à m’apporter ).
Et puis, soyons fous, je vais m’inscrire à nouveau pour cette année.
(Vous pouvez lire la nouvelle récompensée ici : https://lesavocatsdudiable.tumblr.com elle mérite et je la félicite de tout mon coeur)




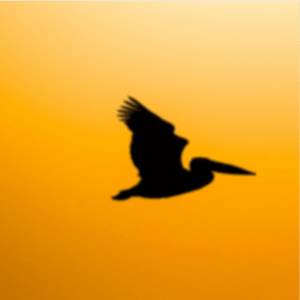 Lorsque mon fils me demande la définition d’un mot, j’ai pour habitude de l’envoyer voir La Rousse…
Lorsque mon fils me demande la définition d’un mot, j’ai pour habitude de l’envoyer voir La Rousse… J’avais besoin de murmurer à l’écorce, de confier-déposer à la sève de mon
J’avais besoin de murmurer à l’écorce, de confier-déposer à la sève de mon  Elle m’a dit ne pas oser, se cacher, alors même que ça la faisait vibrer.
Elle m’a dit ne pas oser, se cacher, alors même que ça la faisait vibrer. Je vous vois.
Je vous vois.